 NOUS
SOMMES TOUS ACADEMICIENS!!
NOUS
SOMMES TOUS ACADEMICIENS!!
Texte de Charles Beausire
Comme
M. Jourdain faisait de la prose nous sommes académiciens sans le savoir puisque
au siècle des lumières l’escrime faisait partie des arts académiques avec
l’équitation et la danse.
L’académisme
est un phénomène particulier aux activités culturelles qui assimile plus ou
moins «culture» et «civilisation».
L’académie
est un instrument parmi d’autre de ce processus de «civilisation» des mœurs
qui branche aussi bien l’élite intellectuelle que l’aristocratie. Leurs
enfants allaient devoir en apprendre les règles; soit le maniement de l’épée,
les lois de l’équitation et l’art de la danse ce que l’on appelait
justement des «académies».
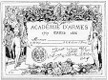
L’ACADEMIE
D’ARMES
La
première institution connue en France sous le nom «d’académie» fut celle
des maîtres d’armes. Créée par privilège royal en 1867 et placée sous
l’égide du patron mémorable de l’escrime, saint Michel, cette compagnie
arriva à son apogée sous Louis XIV, qui confirma les règlements et les
statuts établis par ses prédécesseurs et accrut encore ses nombreux privilèges.
Fondée au cours du règne de Charles IX l’académie continua de jouir de la
bienveillance des règnes successifs, jusqu’à la révolution.
Tout
en promulguant ces lois contre l’usage si répréhensible que les duellistes
faisaient de leur épée, Louis XIV ne perdait pas de vue les avantages inhérents
à la pratique de l’escrime, et voulut se montrer le protecteur éclairé de
la science des armes.
Il
institua des Académies, leur donna par lettres patentes des statuts et règlements,
et fixa à vingt le nombre des professeurs à Paris. Mais ce n’était là que
le côté matériel de l’institution. Louis XIV comprit qu’il fallait
l’entourer d’une juste considération. Il octroya donc des lettres de
noblesse aux titulaires, autorisa les plus anciens d’entre eux à porter une
plaque avec deux épées en sautoir sur fond d’azur et quatre fleurs de lys
surmontées d’un casque. Chacun de ces professeurs avait droit à une place réservée
dans les théâtres royaux; de plus, le privilège de suivre les chasses de la
cour, et de faire revêtir à ses gens la livrée du roi.
Assurément
cela constituait une position très sortable: mais il fallait la conquérir -
c’est le cas de le dire - à la pointe de l’épée.
D’après
les statuts et règlements, l’on ne pouvait se mettre sur les rangs, sans attester au préalable que l’on avait travaillé pendant six années consécutives
chez le même maître. Puis venait l’épreuve de l’assaut qui consistait
dans le tir avec le fleuret seul, ensuite avec le fleuret et le poignard. S’il
arrivait au candidat d’être touché trois fois de suite, il était renvoyé
à un autre examen dans un délai fixé.
attester au préalable que l’on avait travaillé pendant six années consécutives
chez le même maître. Puis venait l’épreuve de l’assaut qui consistait
dans le tir avec le fleuret seul, ensuite avec le fleuret et le poignard. S’il
arrivait au candidat d’être touché trois fois de suite, il était renvoyé
à un autre examen dans un délai fixé.
Cet
assaut qui avait lieu en présence d’un nombreux concours d’amateurs, était
comme la pierre de touche des connaissances que possédait le récipiendaire. Il
avait cet excellent résultat d’exciter une noble émulation parmi les
concurrents, et de les faire participer ainsi à la perfection de leur art.
L’ancienne
Académie d’armes comptait alors vingt membres dont les six premiers étaient
nobles de droit et décorés des ordres royaux. Seuls ces vingt membres avaient
le droit de mettre pour enseigne, à la porte de leur salle d’armes, le bras
armé d’une épée qu’en langue héraldique on désigne sous le nom de
dextrochère.
Cette
société, dont la mission et l’utilité pratique étaient justement reconnues,
décernait, après épreuves, des diplômes et recevait les maîtres qui se
montraient dignes d’être admis parmi ses membres. C’était en quelque sorte
le Conservatoire d’une science qui depuis le XVIe siècle est restée
essentiellement française.
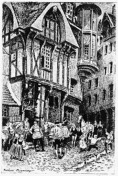 L’une
des plus anciennes académies fut ouverte à cette époque par un Maître dont
malheureusement le nom ne nous est pas connu. Il professait rue de l’arbre
sec, sise près du Louvre comme il se doit.
L’une
des plus anciennes académies fut ouverte à cette époque par un Maître dont
malheureusement le nom ne nous est pas connu. Il professait rue de l’arbre
sec, sise près du Louvre comme il se doit.
Lors d’une prochaine escapade dans la
Ville lumière, pourquoi n’iriez-vous pas faire un petit pèlerinage dans
cette ancienne rue toujours ouvertes. L’immeuble est méconnaissable, mais si
vous allez vous restaurer «Chez la Vieille» vous pourrez constater que
l’escalier humide et sombre est en harmonie avec les planchers de guingois que
l’on ne serrait pas surpris de voir éclairés aux chandelles. En récompense
les repas de la patronne sont succulents (pub gratuite).


Si
d’aventure vous croisiez un «black» dans la rue, ce pourrait être Monsieur
de Saint-Georges mais hélas ce serait une hallucination ou alors son fantôme.
En 1752 le célèbre mulâtre habitait rue Saint-Honoré et passait tous les
jours devant cet immeuble dans ce quartier le plus huppé de la capitale. Le Maître,
Monsieur de la Boëssière y avait installé son académie d’armes. Il était
réputé
comme
l’un des meilleurs enseignants en escrime de Paris. Il prit Saint-Georges sous
sa houlette comme c’était un travailleur acharné, ses protégés
comprenaient bien vite que pour progresser ils auraient à passer de nombreuses
heures à répéter des enchaînements fastidieux avant d’être admis de
croiser le fer.
Ce
perfectionniste sera d’ailleurs l’inventeur du masque en treillis métallique
que nous utilisons toujours agrémenté de quelques améliorations, telles que
rembourrages qui le rendent plus confortable.
 Le
fils de M. de la Boëssière de 5 ans plus âgé que Saint-George écrivit en
1818 un traité de l’art des armes que l’on peut encore consulter à la
bibliothèque du fort de Vincennes.
Le
fils de M. de la Boëssière de 5 ans plus âgé que Saint-George écrivit en
1818 un traité de l’art des armes que l’on peut encore consulter à la
bibliothèque du fort de Vincennes.
Sous le 1er empire les Maîtres d’armes
recevaient le superbe diplôme dont vous avez une illustration ci-dessus, pour décorer
les murs de leur académie.
Parmi
les nombreux faits dont peut se vanter le célèbre mulâtre on peut citer
l’assaut qu’il livra en soirée de gala à Londres avec un non moins célèbre
bretteur, la chevalière d’Eon de Beaumont.
Ces 2
personnages dont je ne saurais trop vous recommander de lire les exploits dans
les biographies qui leur sont consacrées par Alain Guéder pour Saint-Georges
et Edith Moreels pour d’Eon; s’entraînaient lors de leurs séjours à
Londres chez Maître d’Angelle. On lui doit un magnifique volume de
vulgarisation illustré par les figurines célèbres qui décorent même notre
académie.
exploits dans
les biographies qui leur sont consacrées par Alain Guéder pour Saint-Georges
et Edith Moreels pour d’Eon; s’entraînaient lors de leurs séjours à
Londres chez Maître d’Angelle. On lui doit un magnifique volume de
vulgarisation illustré par les figurines célèbres qui décorent même notre
académie.
 Pour
clore ce chapitre sur les académies on ne saurait mieux faire à l’occasion
de la parution du 20eme No de l’Epée d’Argent que de rappeler que la nôtre
possédait un superbe panonceau dont nous ne pouvons que déplorer la
disparition.
Pour
clore ce chapitre sur les académies on ne saurait mieux faire à l’occasion
de la parution du 20eme No de l’Epée d’Argent que de rappeler que la nôtre
possédait un superbe panonceau dont nous ne pouvons que déplorer la
disparition.
Néanmoins
nous possédons toujours les magnifiques fresques dues au pinceau d’Hippolyte
COUTAU qui ornent nos cimaises. (Article déjà paru dans la revue no 7 de mars
1998, pages 16 - 20).
Si à
la longue nous les regardons d’un æil distrait et peut-être blasé, nous
avons toujours autant de plaisir à tirer sous leur regard bienveillant!
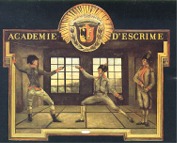 J’espère qu’il en est de même pour
vous et je souhaite à notre red.-en-chef bon courage pour les 20 prochains Nos
en le remerciant pour l’énergie qu’il dépense pour mener à bien cette
entreprise plus absorbante qu’il n’y paraît. Son but: lutter contre
l’apathie et l’indifférence qui s’installent si facilement dans un club
qui ronronne dans la facilité. Sa seule récompense sera de voir le succès lui
sourire.
J’espère qu’il en est de même pour
vous et je souhaite à notre red.-en-chef bon courage pour les 20 prochains Nos
en le remerciant pour l’énergie qu’il dépense pour mener à bien cette
entreprise plus absorbante qu’il n’y paraît. Son but: lutter contre
l’apathie et l’indifférence qui s’installent si facilement dans un club
qui ronronne dans la facilité. Sa seule récompense sera de voir le succès lui
sourire.
C B
 NOUS
SOMMES TOUS ACADEMICIENS!!
NOUS
SOMMES TOUS ACADEMICIENS!! NOUS
SOMMES TOUS ACADEMICIENS!!
NOUS
SOMMES TOUS ACADEMICIENS!!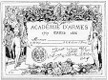
 attester au préalable que l’on avait travaillé pendant six années consécutives
chez le même maître. Puis venait l’épreuve de l’assaut qui consistait
dans le tir avec le fleuret seul, ensuite avec le fleuret et le poignard. S’il
arrivait au candidat d’être touché trois fois de suite, il était renvoyé
à un autre examen dans un délai fixé.
attester au préalable que l’on avait travaillé pendant six années consécutives
chez le même maître. Puis venait l’épreuve de l’assaut qui consistait
dans le tir avec le fleuret seul, ensuite avec le fleuret et le poignard. S’il
arrivait au candidat d’être touché trois fois de suite, il était renvoyé
à un autre examen dans un délai fixé. 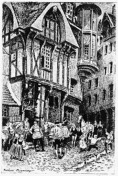 L’une
des plus anciennes académies fut ouverte à cette époque par un Maître dont
malheureusement le nom ne nous est pas connu. Il professait rue de l’arbre
sec, sise près du Louvre comme il se doit.
L’une
des plus anciennes académies fut ouverte à cette époque par un Maître dont
malheureusement le nom ne nous est pas connu. Il professait rue de l’arbre
sec, sise près du Louvre comme il se doit. 

 Le
fils de M. de la Boëssière de 5 ans plus âgé que Saint-George écrivit en
1818 un traité de l’art des armes que l’on peut encore consulter à la
bibliothèque du fort de Vincennes.
Le
fils de M. de la Boëssière de 5 ans plus âgé que Saint-George écrivit en
1818 un traité de l’art des armes que l’on peut encore consulter à la
bibliothèque du fort de Vincennes.  exploits dans
les biographies qui leur sont consacrées par Alain Guéder pour Saint-Georges
et Edith Moreels pour d’Eon; s’entraînaient lors de leurs séjours à
Londres chez Maître d’Angelle. On lui doit un magnifique volume de
vulgarisation illustré par les figurines célèbres qui décorent même notre
académie.
exploits dans
les biographies qui leur sont consacrées par Alain Guéder pour Saint-Georges
et Edith Moreels pour d’Eon; s’entraînaient lors de leurs séjours à
Londres chez Maître d’Angelle. On lui doit un magnifique volume de
vulgarisation illustré par les figurines célèbres qui décorent même notre
académie. Pour
clore ce chapitre sur les académies on ne saurait mieux faire à l’occasion
de la parution du 20eme No de l’Epée d’Argent que de rappeler que la nôtre
possédait un superbe panonceau dont nous ne pouvons que déplorer la
disparition.
Pour
clore ce chapitre sur les académies on ne saurait mieux faire à l’occasion
de la parution du 20eme No de l’Epée d’Argent que de rappeler que la nôtre
possédait un superbe panonceau dont nous ne pouvons que déplorer la
disparition. 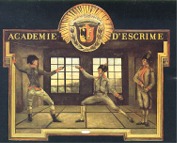 J’espère qu’il en est de même pour
vous et je souhaite à notre red.-en-chef bon courage pour les 20 prochains Nos
en le remerciant pour l’énergie qu’il dépense pour mener à bien cette
entreprise plus absorbante qu’il n’y paraît. Son but: lutter contre
l’apathie et l’indifférence qui s’installent si facilement dans un club
qui ronronne dans la facilité. Sa seule récompense sera de voir le succès lui
sourire.
J’espère qu’il en est de même pour
vous et je souhaite à notre red.-en-chef bon courage pour les 20 prochains Nos
en le remerciant pour l’énergie qu’il dépense pour mener à bien cette
entreprise plus absorbante qu’il n’y paraît. Son but: lutter contre
l’apathie et l’indifférence qui s’installent si facilement dans un club
qui ronronne dans la facilité. Sa seule récompense sera de voir le succès lui
sourire.